Journée commémorative de l'abolition de l'esclavage 2026
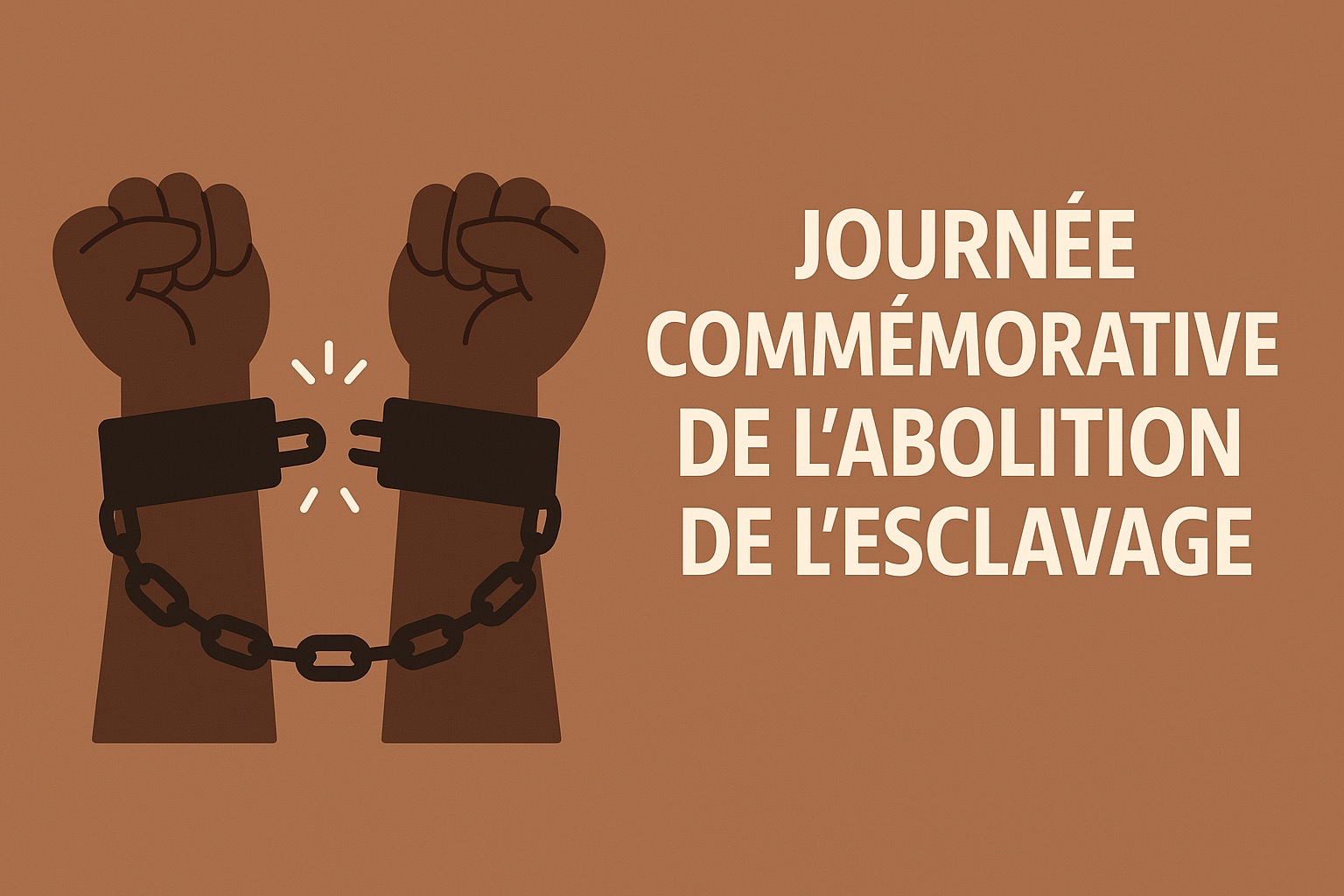
J-95
Dimanche 10 mai 2026
La journée commémorative de l'abolition de l'esclavage est une occasion de rappeler l’histoire de la traite négrière et de l’esclavage, ainsi que les luttes qui ont conduit à leur abolition. Elle permet de rendre hommage aux victimes et de sensibiliser le public aux conséquences durables de cette période sur les sociétés contemporaines.
Selon les pays, cette journée est célébrée à différentes dates, en fonction des événements marquants de leur histoire nationale. En France, elle est fixée au 10 mai, date choisie en 2006 en référence à l’adoption de la loi Taubira du 21 mai 2001, reconnaissant la traite et l’esclavage comme crimes contre l’humanité.
Origine de la journée
L’abolition de l’esclavage résulte d’un long processus marqué par des révoltes d’esclaves, des mobilisations abolitionnistes et des décisions politiques. En France, une première abolition est décrétée en 1794 sous la Révolution, mais Napoléon Bonaparte la rétablit en 1802. Il faut attendre le 27 avril 1848 pour qu’un décret signé par Victor Schœlcher mette définitivement fin à l’esclavage dans les colonies françaises.
D’autres pays ont également connu des abolitions progressives : le Royaume-Uni abolit l’esclavage en 1833, les États-Unis en 1865 avec le treizième amendement, et le Brésil en 1888, devenant le dernier pays des Amériques à interdire cette institution.
Pourquoi cette journée ?
Cette journée vise plusieurs objectifs :
- Préserver la mémoire des victimes de l’esclavage et honorer leur résistance.
- Éduquer les citoyens sur l’histoire de la traite négrière et de l’esclavage colonial.
- Favoriser la réflexion sur les héritages et les conséquences actuelles de cette période, notamment en matière de discriminations et d’inégalités.
- Encourager la lutte contre les formes contemporaines d’esclavage, telles que la traite des êtres humains et le travail forcé.
Chiffres clés et faits marquants
- Environ 12 à 15 millions de personnes ont été déportées d’Afrique vers les Amériques entre le XVIᵉ et le XIXᵉ siècle dans le cadre de la traite transatlantique.
- La France a été un acteur majeur de cette traite, avec plus de 1 400 expéditions négrières organisées entre le XVIIᵉ et le XIXᵉ siècle.
- Le décret du 27 avril 1848 met officiellement fin à l’esclavage dans les colonies françaises, libérant environ 250 000 esclaves.
- La loi Taubira du 21 mai 2001 reconnaît la traite et l’esclavage comme crimes contre l’humanité, faisant de la France l’un des premiers pays à adopter une telle législation.
Actions autour de cette journée
Chaque année, cette journée donne lieu à diverses manifestations officielles et initiatives citoyennes :
- Cérémonies officielles : En France, une cérémonie nationale se tient au Jardin du Luxembourg à Paris, en présence du président de la République et de représentants associatifs.
- Expositions et conférences : De nombreux musées et institutions culturelles organisent des expositions temporaires et des débats sur l’histoire de l’esclavage et ses répercussions.
- Projections et spectacles : Des films, documentaires et représentations théâtrales abordent la mémoire de l’esclavage et les luttes pour l’égalité.
- Actions pédagogiques : Des établissements scolaires proposent des ateliers et des interventions d’historiens pour sensibiliser les élèves à cette histoire.
À travers ces initiatives, cette journée contribue à maintenir le devoir de mémoire et à promouvoir une réflexion collective sur les enjeux de justice et d’égalité.
Éditions précédentes
La Journée commémorative de l'abolition de l'esclavage 2025 était le samedi 10 mai 2025.
En 2024, elle avait lieu le vendredi 10 mai 2024.